Liouba Vinogradova, Les Combattantes. Les aviatrices soviétiques contre les as de la Luftwaffe, Editions Heloïse d’Ormesson, 2016.
La participation des femmes soviétiques à la guerre contre l’Allemagne au sein d’unités de combat est un phénomène bien connu, notamment grâce à des ouvrages anglo-saxons dont celui de Bruce Myles paru en français en 1993. Le livre de Liouba Vinogradova revient sur l’histoire de ces femmes qui servirent dans l’armée de l’air soviétique que ce soit comme pilotes, mécaniciennes ou navigatrices.
L’initiative d’enrôler des femmes dans l’aviation revient à Marina Raskova, célèbre pilote soviétique des années 1930, détentrice du record de la plus longue distance parcourue en avion en 1938. Forte de sa célébrité et de ses entrées au Kremlin, elle parvient à convaincre Staline de former le 122e groupe d’aviation composé exclusivement de femmes. Ce groupe comprend par la suite trois régiments d’aviation, le 586e régiment de chasse, le 587e régiment de bombardement et le 588e régiment de bombardement de nuit. Il est composé de volontaires issues de tous les milieux sociaux, ouvrières, étudiantes, techniciennes.
C’est à travers le regard de ces femmes que Liouba Vinogradova s’attache à décrire le destin particulier de quelques-unes, aussi bien des anonymes que celles qui firent la une des journaux comme Lidya Litvak. Pour cela, l’auteur s’appuie à la fois sur des documents d’archives, des correspondances et des souvenirs et fait ainsi entendre la voix de celles qui sacrifièrent une partie de leur jeunesse, voire leur vie pour défendre leur pays.
Liouba Vinogradova, dans un style clair et particulièrement agréable, retrace ainsi le quotidien de ces femmes aviatrices. De leur apprentissage militaire à Engels aux différentes batailles auxquelles elles prennent part, elle décrit les multiples facettes du vécu de ces femmes, leurs difficultés matérielles, les peurs, les amitiés, les amours, les rapports avec leurs familles à l’arrière, la volonté, aussi, de conserver des signes de féminité dans un univers où les normes dominantes sont masculines. Liouba Vinogradova montre également les divisions qui s’installent entre elles, notamment en raison des différences de grades et de la hiérarchie qui existe entre mécaniciennes et pilotes.
L’auteur ne fait pas l’impasse sur les difficultés que rencontrent les femmes au sein de l’armée. La hiérarchie militaire, si elles acceptent de les employer dans l’armée, rechigne néanmoins à les mettre en première ligne. C’est en effet l’extrême gravité de la situation militaire de l’Union soviétique de juin 1941 au début de 1943 qui permet de briser la division traditionnelle des genres face à la guerre. Les femmes volontaires doivent néanmoins faire la démonstration de leur capacité à combattre à l’égal des hommes. Cela ne se passe pas toujours sans difficultés. Elles subissent les quolibets et moqueries des hommes tandis que la hiérarchie cherche à les isoler, aussi bien des combattants masculins que des combats dont elles sont peu à peu éloignées au fil du temps, à fur et à mesure que l’Armée rouge prend le dessus sur la Wehrmacht. Celles qui parviennent néanmoins à se battre en première ligne, à l’image de Lidya Litviak, la plus célèbre d’entre elles, ne déméritent pas et surpassent bien souvent leurs camarades masculins.
L’ouvrage se termine avec la mort de Lidya Litvak en juillet 1943 qui marque le moment où les femmes dans l’aviation soviétique sont retirées des premières lignes pour réaliser des missions de soutiens et de protection à l’arrière. Les victoires soviétiques qui suivent la bataille de Stalingrad réinstallent la division des genres. L’URSS, de plus en plus assurée d’aller à la victoire, n’a plus besoin de femmes pour combattre les armes à la main.
Le livre de Liouba Vinogradova, offre ainsi à voir, vu d’en bas, ce que fut le destin, les souffrances, mais aussi les joies des centaines de femmes qui démontrèrent par leur courage l’absurdité de l’expression « sexe faible ». Était-il besoin d’une guerre pour cela ?









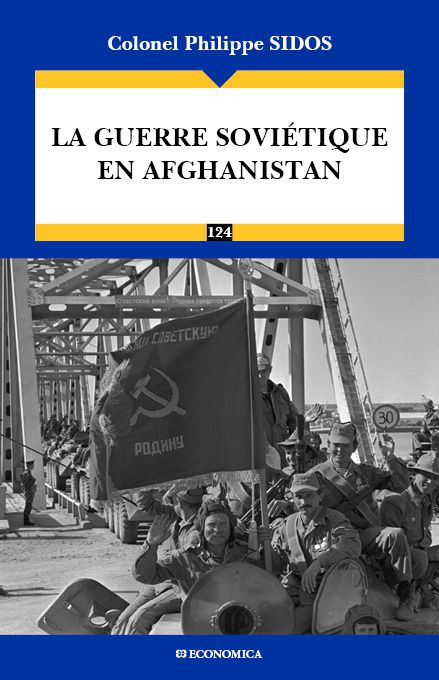




 Serge Wolikow, Alexandre Courban, David François, Christian Oppetit,
Guide des archives de l'Internationale communiste, 1919-1943, Archives nationales-MSH Dijon, Paris-Dijon, 2009.
Serge Wolikow, Alexandre Courban, David François, Christian Oppetit,
Guide des archives de l'Internationale communiste, 1919-1943, Archives nationales-MSH Dijon, Paris-Dijon, 2009.
 Serge Wolikow (sld), Pierre Sémard,
Le Cherche-Midi, Paris, 2007, (Rédaction du chapitre "La mise à l'écart (1929-1932)")
Serge Wolikow (sld), Pierre Sémard,
Le Cherche-Midi, Paris, 2007, (Rédaction du chapitre "La mise à l'écart (1929-1932)")