Dés sa naissance, la Russie soviétique eut à se battre contre des adversaires de différentes natures. Dans la guerre civile qui dura de 1918 à 1920 apparurent donc des chefs militaires de talent comme Toukhatchevski et Frounzé et de nombreux autres qui laissèrent une place plus ou moins grande dans l’historiographie de l’ Armée rouge. Pourtant, le premier de ces commandants, le vainqueur de l’Ukraine et de la Bessarabie, celui à qui Lénine confia la direction du front le plus important est un peu tombé dans l’oubli. Il est vrai que ce soldat impitoyable, adoré par la troupe en raison de ses origines paysannes et de sa propension au pillage, fut un critique des « dictateurs du Kremlin » qu’il finit par trahir. Mikhaïl Mouraviev, puisqu’il s’agit de lui, se rêva en Napoléon rouge avant de mourir tragiquement en prenant les armes contre Lénine.
Officier de l’armée du tsar au service des bolcheviks.
Mikhaïl Artemevitch Mouraviev voit le jour le 13 septembre 1880 dans une famille de paysans du petit village de Bourdoukovo dans district de Vetlouchski qu’arrose la Vetlouga au cœur de la province de Nijni-Novgorod entre Moscou et l’Oural. Remarqué par l’instituteur du village qui l’aide a terminé sa scolarité à l’école du district le jeune Mouraviev s’inscrit dans un séminaire d’enseignement, un établissement secondaire destiné à former les instituteurs. Mais au lieu de devenir maître d’école, ce dernier s’engage dans l’armée en 1898. Après deux ans à l’école d’infanterie de Kazan pour devenir officier, il rejoint la ville de Roslav, dans la province de Smolensk, où il se fait remarquer par ses qualités, notamment par le général Kouropatkine.
La carrière du jeune sous-lieutenant est pourtant largement compromise à la suite d’un duel où Mouraviev tue un officier qui avait offensé sa bien-aimée. Il est alors dégradé et condamné à passer un an et demi dans une compagnie disciplinaire. Mais grâce à l’intervention de protecteurs, il ne passe finalement que quelques mois en prison avant de retrouver son grade.
En 1904, au moment où commence la guerre contre le Japon, le lieutenant Mouraviev commande une compagnie du 122e régiment de Tambov. En février 1905, il est grièvement blessé à la tête et se fait soigner à l’étranger. Selon certains, il passe quelque temps à Paris où il aurait suivi des cours à l’École de guerre tandis que d’autres affirment qu’il se serait lié aux socialiste-révolutionnaires proposant d’organiser pour eux des opérations militaires en Russie. Cette dernière affirmation semble ressortir du domaine de la légende puisque Azef, le chef de l’organisation militaire des SR, étant également un agent de l’Okhrana, la police secrète tsariste, Mouraviev aurait été inévitablement arrêté à son retour au pays s’il avait proposé ses services aux révolutionnaires. Au lieu de cela, il sert pendant un an au Caucase avant de rejoindre l’école d’infanterie de Kazan où il enseigne pendant sept ans et épouse la fille du commandant de réserve Skopinski.
Quand débute la Première Guerre mondiale, Mouraviev est capitaine. Envoyé sur le front, il se bat bravement, recevant décorations et blessures, mais sa carrière stagne néanmoins. Reconnu inapte au front en raison de son état de santé, il est affecté, toujours comme capitaine, comme professeur de tactique à l’école militaire d’Odessa.
Mouraviev, officier de l'armée du tsar
La révolution de février 1917 bouscule le capitaine Mouraviev qui devient un révolutionnaire actif et éloquent avant de rejoindre les rangs du Parti socialiste-révolutionnaire. Durant cette période il apparaît comme un soutien du Gouvernement provisoire et de la poursuite de la guerre. Ainsi en mai 1917 lors d’un congrès d’officiers, Mouraviev avance l’idée de créer des bataillons de choc et procède ensuite à leur organisation. À l’automne 1917, il est enfin lieutenant-colonel en poste à Petrograd.
Deux jours après la prise du pouvoir par les bolcheviks, Mouraviev se rend à Smolny, quartier-général de ces derniers où il rencontre Yakov Sverdlov puis Lénine pour leur proposer ses services. À Petrograd, l’anarchie règne, les caves du Palais d’Hiver ont été pillés et de nombreux soldats, ivres, errent dans la ville où les pilleurs sévissent. Mouraviev qui se présente comme SR de gauche se propose de ramener l’ordre. Il le fait en deux jours de manière particulièrement énergique. Les foules de maraudeurs sont dispersées par la force, les barils d’alcool vidés dans les égouts. Au Palais d’Hiver où des milliers de bouteilles ont été cassés dans les caves, l’alcool est pompé par le croiseur Aurore et rejeté dans la Néva. Fort de cette prompte remise en ordre, Mouraviev est nommé commandant de la région militaire de Petrograd avec les pleins pouvoirs.
Dans le même temps, marchent sur Petrograd les troupes de Krasnov, fidèles à Kerenski. Pour leur faire face, les bolcheviks ne disposent que des gardes rouges, des ouvriers armés, incapables de faire face aux cosaques et aux canons. Il est donc nécessaire de mobiliser des militaires et pour cela de convaincre les officiers de la garnison de défendre la révolution. Vladimir Antonov-Ovseenko raconte dans ses mémoires, comment Mouraviev, après trois heures de discussions, parvient à convaincre des officiers, restés jusque-là neutres, de conduire leurs hommes au combat. Les unités de Krasnov sont finalement repoussées tandis que Kerensky prend le chemin de l’exil.
Mouraviev apparaît alors aux yeux des bolcheviks comme une autorité militaire indispensable pour défendre le pouvoir soviétique. Mais ce dernier se retrouve vite dans une situation inconfortable lorsqu’un conflit éclate entre bolcheviks et SR de gauche, ces derniers demandant à leurs militants de quitter leurs fonctions au sein du pouvoir soviétique. Mouraviev obtempère et démissionne le 21 novembre. À la suite d’un nouveau rapprochement entre les deux partis, Mouraviev est nommé, le 22 décembre, chef d’état-major du commissaire du peuple pour la lutte contre la contre-révolution en Ukraine, Antonov-Ovseenko.
La conquête de l’Ukraine.
En Ukraine, l’annonce de la chute du tsarisme ne parvient à Kiev que le 3 mars 1917. Le 7 mars, des partis et mouvements locaux mettent sur pied une assemblée représentative, la Rada centrale, qui doit gérer la région dans le cadre d’une certaine autonomie au sein de l’ensemble russe. Pourtant le gouvernement provisoire de Petrograd ne reconnaît pas cet organisme qui continue néanmoins à se développer intégrant des représentants des minorités nationales et des différents partis dont des bolcheviks. Ces derniers se retirent de la Rada quand en octobre celle-ci refuse de reconnaître la prise du pouvoir par les bolcheviks à Petrograd. Le 20 novembre, la Rada annonce la création de la République populaire ukrainienne au sein d’un État fédéral russe. En réponse, les bolcheviks réunissent le 25 décembre à Kharkov le premier congrès des soviets d’Ukraine qui proclame la formation d’une république socialiste soviétique d’Ukraine et met hors la loi la Rada. Afin de renverser cette dernière, Antonov-Ovseenko et Mouraviev sont envoyés en Ukraine.
Mouraviev inaugure alors la tactique militaire dite de « la guerre des échelons » qui repose sur les trains blindés. Cette tactique est à la fois simple et d’une certaine efficacité. Un train rempli d’un échelon de soldats fait irruption dans une gare, ces derniers débarquent rapidement et attaquent précipitamment leurs adversaires. La méthode est efficace puisque pour prendre la gare de Poltava, Mouraviev ne perd qu’un soldat. Cette tactique montre à tous les belligérants l’importance des chemins de fer dans un pays vaste comme la Russie où les forces mobilisées sont encore faibles, Mouraviev ne disposant que de 3 000 combattants pour conquérir l’Ukraine.
Les troupes rouges en marche sur Kiev
En cinq semaines, les troupes de la Rada dirigées par Simon Petlioura sont vaincues et les Soviétiques ne cessent d’avancer en Ukraine. Les forces ukrainiennes manquent d’unités et d’un commandement capable. Le territoire de la République populaire ukrainienne ne cesse de rétrécir tandis qu’à Kiev, le 18 janvier 1918, les ouvriers de l’Arsenal se lancent dans une insurrection armée. Le 24 janvier, la Rada proclame l’indépendance totale de l’Ukraine.
Le 27 janvier, Mouraviev approche de Kiev. Son armée compte alors 7 000 hommes, 26 canons, 3 auto-blindés et 2 trains blindés. Il fait bombarder les quartiers bourgeois de la ville. Kiev est touché par prés de 2 000 obus qui causent d’importants dégâts et font de nombreuses victimes civiles. Cette action, alors que la Rada est en pleine déroute, provoque la colère chez les Ukrainiens, une colère qui prend pour cible les bolcheviks et notamment Mouraviev d’autant qu’il est aussi reproché à ce dernier de livrer les villes prises au pillage de ces soldats. Les autorités soviétiques en Ukraine demandent donc à Moscou son rappel. Le 14 février, Mouraviev est nommé à la tête des troupes qui doivent s’opposer à l’avance des armées roumaines, qui après s’être emparées de la Bessarabie, avancent vers Odessa.
La guerre contre la Roumanie.
La Roumanie s’est engagée dans la Première Guerre mondiale en 1916 aux côtés des puissances de l’Entente. Mais l’armée roumaine est battue par les troupes allemandes et bulgares qui occupent Bucarest et une grande partie du pays. La Roumanie n’évite la défaite totale que grâce au soutien et à l’intervention russes. Ses troupes tiennent le front en Bessarabie tandis que le gouvernement et le parlement s’installent à Iasi. À la fin de 1917, au moment de la désagrégation de l’armée russe, les Roumains s’emparent des stocks d’armes et d’approvisionnements russes. Le 7 décembre, deux régiments roumains traversent le Prout qui marque la frontière avec la Russie et occupent quelques villages. Début janvier, la conquête commence. Le 13 janvier, après avoir désarmé les gardes rouges, les Roumains prennent Chisinau. Des combats embrassent le nord de la Bessarabie. Bendery résiste du 29 janvier au 7 février, défendue par des milices municipales, des détachements ouvriers et des soldats des 5e et 6e régiments Zamourski. Pour prix de cette résistance, les Roumains fusillent prés de 500 personnes.
Le 26 janvier, la Russie soviétique rompt ses relations diplomatiques avec Bucarest et confisque l’or que les Roumains avaient mis à l’abri en Russie. Pour résister à cette dernière se forme le 18 janvier la République soviétique d’Odessa (RSO) qui comprend des territoires des provinces de Kherson et de Bessarabie. Pour se défendre, elle ne dispose que d’unités éparses des 4e et 6e armées du front roumain. Concentrées dans le district de Tiraspol, ces forces forment une « armée spéciale » avec un commandement élu. Avec les troupes de la République soviétique d’Odessa, elle ne rassemble que de 5 000 à 6 000 hommes dont seulement 1 200 cavaliers et 1 500 fantassins véritablement en état de combattre. Pour organiser la défense de la région il existe également un comité central exécutif des soviets du front roumain, de la flotte de la mer Noire et de la région d’Odessa (Roumtcherod) dont l’autorité s’étend sur les provinces de Kherson, de Bessarabie, de Tauride et une partie des provinces de Podolsk et de Volhynie.
Ce sont les commissaires du Roumtcherod qui organisent concrètement la défense contre les troupes roumaines. À la suite d’accrochages sur le Dniestr, il propose au commandement roumain de signer un armistice afin d’entamer des négociations, armistice finalement conclu le 8 février. Les Roumains ont accepté la proposition car ils ont sous-estimé la résistance des Soviétiques tandis que leurs soldats rechignent à combattre les Russes. Pendant ce temps, Mouraviev et sa petite armée ne cessent de progresser en Ukraine élargissant le territoire sous contrôle soviétique. A Odessa, le conseil des commissaires du peuple de la RSO forme un collège spécial pour la lutte contre la contre-révolution roumaine et bessarabienne qui s’immisce dans les négociations entre les Roumains et le Roumtcherod qui sont finalement interrompues le 15 février.
Le 14 février, Mouraviev est officiellement chargé de chasser les Roumains du territoire russe avec comme consigne de Lénine d’agir « on ne peut plus énergiquement sur le front roumain ». Ce dernier lui indique qu’il reste en Bessarabie quelques unités de la 8e armée ralliées aux bolcheviks qu’il peut donc intégrer aux troupes rouges. Mais à Kiev Mouraviev rencontre des difficultés avec les hommes qu’il commande déjà. Les gardes rouges estiment en effet avoir rempli leur mission en « libérant » l’Ukraine et ne veulent pas suivre Mouraviev en Bessarabie. La colère de ce dernier ne change rien à cette situation et il ne parvient à rassembler que 2 000 combattants qu’il lance en direction du Dniestr vers Bendery et Odessa où il installe son état-major. Arrivé sur place, il envoie un télégramme à Lénine : « La situation est extrêmement grave. Les troupes de l’ancien front sont désorganisées, en réalité ce front n’existe plus, il n’en reste seulement que les état-majors dont les emplacements sont inconnus. Le seul espoir repose sur l’arrivée de renforts extérieurs. Le prolétariat d’Odessa est désorganisé et politiquement analphabète. Ignorant que l’ennemi se rapproche d’Odessa, il ne s’en soucie pas. »
Le 20 février, les troupes de Mouraviev lancent une offensive sur Bendery, détruisant un régiment roumain et s’emparant de trois canons tandis que les soldats du Roumtcherod contiennent les Roumains sur le Dniestr. Plus au nord, directement sous les ordres de Mouraviev, les gardes rouges infligent également une défaite aux Roumains prés de Rybnitsa le 23 février. Les combats se poursuivent pendant six jours avec la victoire des Soviétiques à Slobozia, dans la région de Kitskany. Les Roumains proposent alors de négocier et les pourparlers s’engagent à Odessa et Iasi. Un accord est trouvé le 5 mars mettant fin au conflit entre la Russie soviétique et la Roumanie qui s’engage à évacuer ses troupes de Bessarabie dans les deux mois et à n’entreprendre aucune action militaire contre le pouvoir soviétique. Cet accord est rapidement rendu caduc par l’invasion allemande et austro-hongroise.
Le 9 février 1918, les représentants de la Rada ukrainienne signent un accord avec les Allemands à Brest-Litovsk. Ils acceptent que les troupes du Kaiser envahissent l’Ukraine mais aussi de fournir des vivres au Reich qui souffre cruellement du blocus allié. Près de 450 000 soldats allemands et austro-hongrois s’avancent alors en Ukraine qui devient le grenier à blé d’une Allemagne où la famine menace. Pendant que Mouraviev combat en Bessarabie, les troupes allemandes progressent rapidement en Ukraine où quelques milliers de gardes rouges sont incapables de les arrêter. Le 1er mars, les Allemands entrent dans Kiev, obligeant Mouraviev à quitter Odessa par crainte de se retrouver coupé du reste de la Russie.
La fin de Mouraviev.
Mouraviev arrive à Moscou le 1er avril où il est fêté par les SR de gauche qui voient en lui le chef militaire de la révolution. Il se voit alors confier le poste de commandant de l’armée du Caucase, une décision à laquelle s’oppose les bolcheviks de Transcaucasie qui craignent que les excès dont Mouraviev est prodigue ne soulèvent la population contre le pouvoir soviétique. Deux semaines après son arrivée dans la région, ils font donc arrêter le nouveau commandant en l’accusant d’avoir livré des armes aux anarchistes de Moscou et surtout d’avoir ordonné des exécutions et des expropriations illégales en Ukraine. Mais Lénine ne veut pas se brouiller avec les SR de gauche sur cette question. Il croit toujours dans les talents militaires de Mouraviev et dans sa capacité à sauver la révolution. Il le fait donc libéré et le nomme commandant du front oriental qui comprend trois armés et doit affronter la légion tchécoslovaque. Cette dernière s’est révoltée en mai 1918 contre le pouvoir soviétique et en quelques semaines a pris le contrôle d’immenses territoires dans l’Oural et la Sibérie. Pour le pouvoir soviétique, la menace tchécoslovaque apparaît comme mortelle et la nomination de Mouraviev pour l’écraser montre la confiance que Lénine place en lui.
Cette confiance disparaît quand le 6 juillet, les SR de gauche organisent un soulèvement à Moscou dans le but d’annuler le traité de Brest-Litovsk pour reprendre la guerre contre l’Allemagne. Lénine demande alors de faire surveiller étroitement Mouraviev. Les craintes du leader bolchevik sont fondées puisque Mouraviev reste toujours fidèle au SR de gauche. Pourtant le 6 juillet, il demeure à travailler au sein de son état-major et assure qu’il reste loyal au pouvoir soviétique.
Ce n’est que le 10 juillet que Mouraviev passe à l’action. Si l’historiographie soviétique a longtemps soutenu qu’il avait agi sur ordre et en liaison avec la direction des SR de gauche, aucun document ne corrobore cette version. Il semble plus juste qu’il a agi seul, certainement dans l’espoir d’échapper à une probable arrestation due aux soupçons sur sa loyauté.
De Kazan où est installé l’état-major du front oriental, il embarque avec deux régiments sur un navire et descend la Volga jusqu’à Simbirsk. Pour protester contre le traité de paix de Brest-Litovsk, il se proclame commandant en chef de l’armée en lutte contre l’Allemagne. À ce titre, il télégraphie au conseil des commissaires du peuple, à l’ambassadeur d’Allemagne et au commandant du corps tchécoslovaque une déclaration de guerre au Reich. Aux Tchécoslovaques il demande également de marcher sur la Volga pour ensuite se diriger de concert vers l’ouest afin d’affronter les troupes allemandes.
À Simbirsk, Mouraviev fait arrêter les dirigeants bolcheviks locaux ainsi que le commandant de la 1ere armée rouge, Toukhatchevski. Il appelle à nouveau les Tchécoslovaques et les officiers russes à marcher sur Moscou pour renverser les bolcheviks tandis qu’il rallie des commandants SR de gauche de Simbirsk et Kazan. Alors que Mouraviev commence à installer un pouvoir SR sur la Volga, Moscou envoie à Simbirsk des fusiliers lettons et un détachement spécial de la Tchéka. Le 11 juillet, au moment où les tchékistes viennent pour l’arrêter, Mouraviev sort une arme. Un coup de feu est alors tiré et il s’effondre, tué. Selon les Izvestia du 12 juillet, il se serait donné lui-même la mort.
La trahison de Mouraviev n’est pas sans conséquence pour la jeune Armée rouge. Elle ne fait ainsi qu’accroître la méfiance des commissaires et des soldats contre les anciens officiers de l’armée impériale qui servent au sein des forces soviétiques. Elle a surtout de graves conséquences militaires sur le front oriental. La troupe est en effet démoralisée et décontenancée par les télégrammes de Mouraviev, que ce soit celui qui déclare la guerre à l’Allemagne ou celui demandant la paix aux Tchécoslovaques puis par la disparition du commandant en chef et la reprise des hostilités contre les Tchécoslovaques. Le général Kappel en profite pour lancer une offensive s’emparant de Bougoulma et Kazan puis de Simbirsk en août. Face à l’effondrement du front, Trotski doit se rendre personnellement en train blindé à Sviajsk pour reprendre la situation en main.
Les jugements des contemporains et des historiens sont sévères concernant celui qui fut considéré comme le Napoléon rouge. Animé par une ambition dévorante, il apparaît comme un piètre stratège ne remportant des victoires qu’avec des effectifs trois fois supérieur à ses adversaires. Pour assurer sa popularité parmi la troupe il autorise les pillages et instaure un régime de terreur en Ukraine et à Odessa. Sa réputation de cruauté est telle qu’elle lui aliène de nombreux chefs bolcheviks dont le patron de la Tchéka, Felix Dzerjinski, pourtant peu suspect de complaisance humaniste. Plus sûrement, Mouraviev appartient à cette catégorie d’aventuriers qui n’émerge dans l’histoire que lors des périodes de troubles et d’effondrements des sociétés humaines.










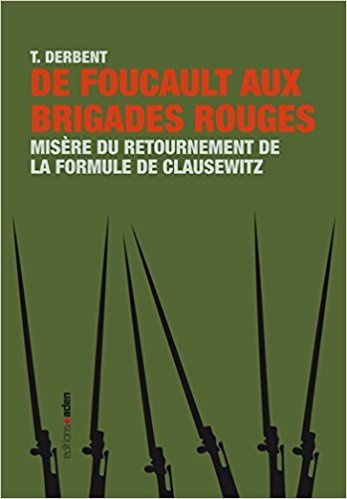
















 Serge Wolikow, Alexandre Courban, David François, Christian Oppetit,
Guide des archives de l'Internationale communiste, 1919-1943, Archives nationales-MSH Dijon, Paris-Dijon, 2009.
Serge Wolikow, Alexandre Courban, David François, Christian Oppetit,
Guide des archives de l'Internationale communiste, 1919-1943, Archives nationales-MSH Dijon, Paris-Dijon, 2009.
 Serge Wolikow (sld), Pierre Sémard,
Le Cherche-Midi, Paris, 2007, (Rédaction du chapitre "La mise à l'écart (1929-1932)")
Serge Wolikow (sld), Pierre Sémard,
Le Cherche-Midi, Paris, 2007, (Rédaction du chapitre "La mise à l'écart (1929-1932)")